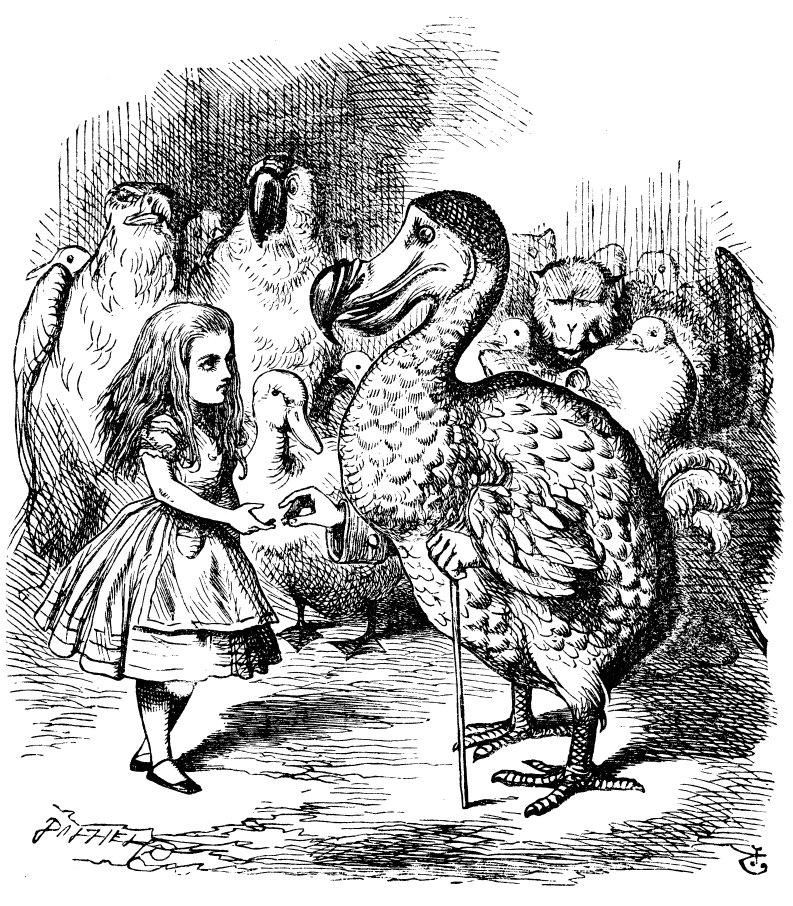Une lettre belle et honnête à l’attention de Greta Thunberg, rédigée par l’essayiste Laurent de Sutter sur la RTBF et que je ne résiste pas à reproduire ici. Un regard admiratif à l’égard d’une jeune personne qui réclame à ce que son discours soit pris au sérieux, parce que l’enjeu est terriblement sérieux et universel, à l’adresse de figures d’autorité souvent condescendantes, encore embuées dans la vieille et persistante croyance que leur position et leur expérience prévalent sur la parole d’un autre, en apparence plus « démuni » d’expérience (en quoi, d’ailleurs?). Sa jeunesse a le mérite du discours limpide, parcouru par l’émotion : en quoi cela ne mérite-t-il pas d’être légitime ? Quand je l’écoute, je pense aux enfants qui crient à l’abus de leurs parents mais, faute de pouvoir se défendre et d’être soutenus, se résolvent au silence. L’enfance, la jeunesse mérite d’être prise au sérieux parce que sa voix va bien au-delà d’elle. Elle n’a pas le souci réfléchi de la censure. La parole révoltée révèle, d’ailleurs, le plus souvent un trouble dans l’environnement familial. Greta Thunberg le fait à grand échelle et sa voix circule…
Laurent de Sutter : « Chère Greta Thunberg, il y a quelque chose de possible »
Chère Greta,
Je n’aurais jamais imaginé vous écrire une lettre un jour. Vous et moi appartenons à des mondes si différents. Vous êtes une jeune fille du 21e siècle, je suis un homme du 20e. Vous êtes remplie de l’espoir de ceux qui pensent qu’ils peuvent changer le monde, je suis le spectateur mélancolique et velléitaire de sa déréliction.
Ce n’est pas que je n’aie jamais voulu m’engager moi-même. Au contraire, je l’ai fait à plusieurs reprises – et je compte bien le faire encore. Mais c’est que mon engagement à moi était un engagement sans effet. C’était celui d’un homme qui a sans doute passé trop de temps à lire, et qui imaginait qu’un combat, quel qu’il soit, a quelque chose de romantique – d’irrésistiblement érotique, même.
Je dois bien l’avouer, chère Greta : mes combats étaient des combats de rêveur, de bourgeois qui s’imaginait qu’il pourrait faire la révolution depuis son salon ou une terrasse de café. Le vôtre, par contraste, ne doit rien au livre ou au rêve. Il est un combat brutal et beau, avec des forces infiniment supérieures en nombre et en pouvoir – des forces qui vous ont vue entrer en scène en ricanant, puis en tentant aussitôt de vous oublier. Ce n’est que lorsque vous êtes revenue, puis revenue encore, jusqu’à occuper la totalité de l’espace qu’ils considéraient leur appartenir en propre, celui des médias, qu’ils se sont inquiétés.
Ils ne vous ont jamais prise au sérieux, pas plus que les dizaines, les centaines de milliers de camarades qui vous ont rejoint tout autour de la planète. Mais tant que vous demeuriez une curiosité, ils pouvaient vous considérer comme telle, avec tout le paternalisme répugnant de ceux qui se sentent au-dessus de tout. Puis, à un moment donné, ils se sont rendu compte de l’avance que vous aviez prise sur eux – de tout ce que vous représentiez, et qu’ils vomissent : le courage, la probité, l’intensité, la joie. Alors, ils ont commencé à libérer leur haine.
Ils vous ont accablée d’insultes, chère Greta. Ils ont raillé votre physique, votre condition mentale. Ils ont moqué votre savoir, dont, soudain, ils faisaient semblant de prétendre qu’il ne recouvrait qu’une partie du problème. En somme, ils ont fait ce qu’ils font toujours : tenter de vous faire passer pour une demi-débile, une naïve en peu demeurée, un attrape-nigaud pour adolescents aux hormones en pagaille. C’était laid. C’était moche. C’était bête. Et, surtout, c’était méchant.
Vous avez pris un bateau à voile qu’on vous prêtait plutôt que l’avion afin de vous rendre aux Etats-Unis pour défendre la cause qui est la vôtre, parce que telle était votre conviction – et même cela vous a valu les railleries et les insultes des malins, des instruits, de ceux qui savent mieux. Vous ne semblez pas en avoir été trop affectée. Tant mieux.
Sachez-le, chère Greta, le spectacle de votre droiture, de votre indifférence, me fait un immense bien.
C’est un spectacle qui, pour une fois, ne réclame aucun commentaire, aucune critique – ni, non plus, aucune adhésion ou aucune foi. Vous n’êtes pas une sainte, une martyre ou une héroïne. Vous ne nous sauverez pas – et, du reste, telle n’est pas votre prétention. Nous ne nous sauverons que nous-mêmes, si nous nous décidons, de la même manière que vous ne réclamez d’être fidèle qu’à vos choix, qu’à votre désir.
Non, chère Greta, le spectacle de votre indifférence signifie autre chose. C’est un spectacle qui veut dire : il y a quelque chose de possible, ici, maintenant, en dehors des salons et des terrasses de café. En dehors aussi des parlements et des officines de presse. Il y a quelque chose de possible, pour autant que nous apprenions à réagir aux discours et aux menaces de ceux qui sont au pouvoir avec la même indifférence que celle que vous manifestez à leur égard. Ceux qui menacent parce qu’ils ont le pouvoir sont sans importance, car, ce pouvoir, ils peuvent le perdre. D’ailleurs, ils l’ont déjà perdu – et ils le savent.
Très cordialement à vous,
Laurent de Sutter
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lettre que j’ai découverte via le compte Twitter de Benoît Peeters. Vous pouvez aussi lire et également écouter la lettre sur le lien suivant de la RTBF :
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_laurent-de-sutter-chere-greta-thunberg-il-y-a-quelque-chose-de-possible?id=10320375